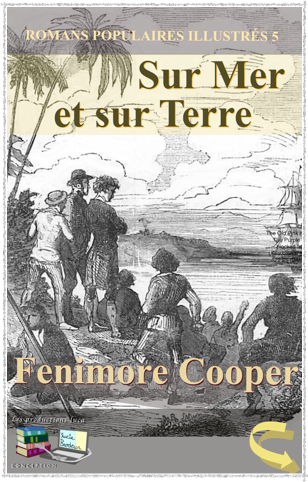Sur Mer et sur Terre

Sommaire
Préface
Introduction
Quelle carrière ?
Réussirons-nous à partir ?
Vers la Chine
Naufrage près de Madagascar
La Folie
Revenir avant l’annonce de notre mort
L’avenir se dessine
Mon premier commandement
En Angleterre
Près de la Terre de feu
Les sauvages
Les maîtres à bord
La bataille
Une nouvelle île
Sous pavillon français
À la poursuite de la Crise
À bord de la Crise
Sur l’île de Marbre
Il veut rester sur son île
Arrivés à New-York
À la maison
Vivre à la campagne
Frère et soeur
L’ouragan
Du nouveau à bord
Rencontres à New-York
Grâce est très malade
On se déclare
Ballade sur l’Hudson
Note du traducteur
La bataille
Quand nous eûmes passé la pointe de l'île, nous sentîmes une douce brise du sud, et en mettant la barre au vent, il me fut possible de maintenir le cap du côté de la pleine mer. La marée favorisa les mouvements de la Crise, qui s'éloigna de la côte avec une vitesse d'environ deux noeuds à l'heure.
C'était une marche lente, mais il fallait aux canots quinze ou vingt minutes pour revenir du fond de la baie et faire le tour de l'île par l'autre passe. Pendant ce temps nous pouvions faire près d'un demi-mille.
Le Grand-Sec était embarrassé, car il n'avait aucune idée de l’action du gouvernail. Toutefois, voyant que la Crise continuait à gagner au large, il s'approcha de moi avec un air farouche qui me démontra qu'une sympathie naturelle n'avait pas été le motif de sa modération précédente.
Il brandit son couteau, et l'appuya deux fois sur ma poitrine en me faisant signe de rentrer au port. Je crus que ma dernière heure était proche. Mais je montrai les mâts pour indiquer au sauvage que le navire ne portait pas ses agrès accoutumés. Il me comprit et m'indiqua un paquet de voiles en murmurant des menaces. Il ramassa la voile de brigantine, qui était auprès de lui, et m'ordonna par gestes de la déployer.
Il est inutile de dire que j'obéis avec une secrète joie. Détachant les cargues, j'indiquai à une douzaine de sauvages ce qu'il y avait à faire, en mettant moi-même la main à l'oeuvre. En peu de temps, je hissai le baume, la trinquette, la grande voile d'étai et le foc d'artimon.
Comme on n'avait point passé la clef dans les mâts de hunes, je ne pouvais utiliser que ces quatre voiles. Elles ajoutèrent un noeud de plus à la marche du navire, et le portèrent sur un point où il sentait toute la force du vent qui soufflait du sud-est.
Le Grand-Sec me suivit avec le regard pénétrant d'un faucon. Comme j'avais obéi à ses ordres en faisant voile, il ne pouvait se plaindre de moi, et les résultats de la manoeuvre le surprenaient. Voyant que le navire continuait à s'éloigner de la baie, il me menaça de nouveau, en me faisant signe de mettre le cap sur la terre.
Je lui demandai un peu de place. Puis je décrivis un long cercle sur le pont, et lui montrai les quatre voiles, pour lui expliquer qu'avec notre voilure actuelle il était indispensable de faire un grand détour. J'ajoutai qu’en mettant les huniers nous parviendrions plus vite au point désiré. Les sauvages me comprirent, et s'offrirent à m'aider. Il était clair qu’ils avaient conservé ma vie uniquement pour m'employer à la direction du navire.
Et comme ils ne pouvaient rien sans moi, mon importance augmentait à mesure que nous avancions en mer. Quand le mâtereau eût été hâlé assez haut, je montai dans les agrès pour passer la clef. Du haut de la hune, j'aperçus les canots qui tournaient autour de l'île, et je jugeai à leur marche qu’ils devaient nous rejoindre dans un espace de vingt minutes.
Il était important de prévenir leur arrivée. En possession de la confiance des sauvages, je réclamai leur assistance afin de hisser le grand foc. J'examinai ensuite les canots avec une lunette. Ils avaient cessé de pagayer, et s'étaient rapprochés les uns des autres, sans doute pour tenir conseil.
Je supposai qu'à l'aspect de la voilure, ils se figuraient que nous avions repris la Crise, et je cherchai des moyens de les confirmer dans cette opinion. J'avais donné au Grand-Sec un cigare pour le mettre de bonne humeur, et j'avais pris la liberté d'en allumer un pour moi. La veille au soir nos canons avaient été amorcés, alignés et débarrassés de leurs tampons.
Il suffisait d'enlever la platine du canon de l'arrière pour qu'il fût prêt à faire feu. Je mis la barre tout au vent, jusqu'à ce que notre bordée portât sur les canots. Puis j'appliquai le cigare à l'amorce, m'élançai à la roue et mis la barre dessous. L'explosion produisit une stupéfaction générale.
Le Grand-Sec s'avança sur moi, le couteau levé. Mais je lui fis remarquer que le vaisseau loffait avec rapidité, et je tâchai de lui faire comprendre par signes que l'emploi du canon avait une influence sensible sur le changement qu'il remarquait.
Le navire continuant à virer, le chef indien crut à la vérité de mes explications, et ce fut avec un air de triomphe qu'il fit observer à ses compagnons la nouvelle marche de la Crise. Quant aux canots, effrayés du sifflement de la mitraille, ils pagayèrent vers le fond de la baie dans la ferme persuasion que nous avions reconquis le navire.
Ainsi le succès dépassait mon attente. Si je parvenais à perdre la terre de vue, mes services devenaient tellement nécessaires que ma vie cesserait d'être en danger. La côte était basse, le vent fraîchissait, la Crise filait quatre noeuds à l'heure, et en maintenant le cap dans la direction convenable, je pouvais, en moins de sept heures, parcourir une vingtaine de milles.
Il était temps d'avoir une conférence avec Marbre. Pour éloigner les soupçons, j'appelai le Grand-Sec auprès du capot d'échelle, afin qu'il fit témoin de l'entretien, quoique je fusse bien convaincu que pas un des sauvages présents à bord n'entendait un seul mot d'anglais.
— Eh bien. Miles, me demanda le premier lieutenant, qu'y a-t-il ? Que veut dire ce coup de canon ?
— C'est moi qui l'ai tiré, monsieur, pour écarter les canots, et j’ai complètement réussi.
— Je le sais. J'avais mis la tête à la fenêtre de la cabine. J'ai vu le boulet tomber à vingt brasses des canots, dont quelques-uns ont été atteints par des éclats de mitraille. Mais que comptez-vous faire ? Nous sommes à plus d'une demi-lieue de la terre. Que doit en penser le Grand-Sec ?
J'expliquai au premier lieutenant notre situation, notre voilure, le nombre de sauvages que nous avions à bord, et les idées qu'ils avalent sur la manière de virer. Le Grand-Sec, pendant cet entretien, m’écoutait avec une attention soutenue, et gesticulait par intervalles pour m'inviter à tourner l'avant vers la côte. Car la Crise, ayant le vent par son travers, avait repris la route de la pleine mer.
Il fallait nécessairement rassurer les sauvages, et en même temps raffermir le grand hunier, qui, sous l'action de la houle de terre, menaçait de consentir au chouquet. Je m'approchai du Grand-Sec, et je vis avec satisfaction qu'il commençait à donner des symptômes du mal de mer, ainsi que plusieurs de ses compagnons.
Je lui montrai les mâts et les vergues, et j'essayai de lui persuader, par une pantomime énergique, qu'il m'était impossible de virer le navire sans le secours de quelques matelots.
Le vieillard secoua la tête, prit un air grave, et finit par prononcer les noms de Nab et de Joë. Ce dernier était le cuisinier nègre, et il avait partagé avec mon domestique l'honneur d'attirer spécialement l'attention des sauvages. Le Grand-Sec supposait sans doute, en cas de lutte, qu'il trouverait dans les noirs des alliés plutôt que des ennemis. Mais j'étais sûr de la fidélité de mon serviteur, et je savais que le cuisinier avait autant d'attachement pour son pavillon que le plus blanc des Américains.
J'indiquai au chef indien les moyens de transporter les deux nègres sur le pont, sans relâcher le reste des prisonniers. On descendit une corde du canot de l'arrière jusqu'aux fenêtres de la cabine. J'avertis le premier lieutenant, et les deux nègres furent hélés tour à tour sur le plat-bord du canot, où ils furent reçus par les sauvages.
Avant de les laisser monter sur le pont, le Grand-Sec leur fit un discours entremêlé de gestes significatifs, dans le but de les prévenir du sort qui les attendait s'ils se conduisaient mal.
J'envoyai les deux nègres à la hune, et bientôt toutes les voiles furent dans une position favorable. En les voyant s'enfler, nos ennemis poussèrent des cris d'allégresse, sans se douter que nous nous écartions de plus en plus du continent. Cependant le Grand-Sec insista de nouveau sur la nécessité de virer de bord. La disparition de la terre l'inquiétait, et, malgré les nausées du mal de mer, il continuait à me surveiller de près.
Pour le calmer, je virai vent devant, avec l’assistance des sauvages, qui exécutèrent mes ordres mieux que je ne me le serais imaginé. Dès qu'ils se virent sur la route de la terre, ils manifestèrent une joie qui tenait du délire. J'eus peine à éviter que leur chef ne me serrât dans ses bras.
La nouvelle marche du navire eut pour effet de diminuer l'active surveillance de nos ennemis, qui, se croyant près d'échapper au danger, cessèrent de résister à leurs souffrances physiques.
Je postai Nabuchodonosor au gouvernail, et, me penchant sur le couronnement, je parvins à attirer Marbre à l'une des fenêtres de la cabine, sans alarmer le chef indien.
J'avais observé que les Indiens évitaient de se tenir sur le gaillard d'avant, à cause des secousses que le tangage imprimait à cette partie du vaisseau. Je dis au premier lieutenant d'y concentrer toutes ses forces, puis je m'éloignai, et feignis de m'occuper entièrement de la manoeuvre.
Le sauvage qui gardait l'écoutille d'avant était dans un état pitoyable, et rendait son tribut à la mer avec des efforts convulsifs. L'écoutille n'était maintenue que par une barre de fer passée dans le crochet, et il n'était pas difficile de l’ouvrir.
Ce fut l'affaire d'un instant. L'équipage, conduit par Marbre, se précipita sur le pont en criant :
— Vengeons le capitaine !
Quand je voulus suivre mes compagnons, la sentinelle de l'écoutille me barra le passage. Le sauvage était armé des pistolets qu'on m'avait enlevés. Mais peu accoutumé à s'en servir, il n'eut pas le temps d'en faire usage. Je l'étreignis dans mes bras, nous roulâmes tous deux sur le pont, et je me rendis bientôt maître de lui.
Pendant que je l’attachais avec le câble qui servait à hâler bas le grand foc, nos matelots, sans tirer un seul coup de fusil, frappaient les sauvages de leurs piques ou les jetaient à la mer. Au moment où j'arrivai au pied du grand mât, le navire était en notre pouvoir, et, de tous les sauvages, il ne restait plus que le Grand-Sec.
Au commencement de l'attaque, Nabuchodonosor, abandonnant le gouvernail, avait passé les bras autour du corps de l'Indien, et le tenait comme dans un étau.
— À la mer, ce misérable ! s'écria le premier lieutenant en fureur.
— Épargnez-le, monsieur Marbre. Il m'a sauvé la vie.
Le nègre avait toujours eu pour mes ordres plus de déférence que pour ceux du capitaine même. Autrement le Grand-Sec eût suivi ses compagnons dans les abîmes de l'Océan. Marbre, qui n’était pas naturellement cruel, dédaigna de frapper un prisonnier sans défense, et se contenta d'ordonner qu'on le gardât à vue.
Satisfait d'avoir réussi, je courus à l'avant pour y prendre l'homme que j'avais attaché, mais il était trop tard. Des matelots s'étaient emparés de ce malheureux, et j'arrivai pour le voir disparaître par le sabord du bossoir. Pendant cette lutte de quelques minutes, la Crise avait suivi sa route, pareille à la terre qui se meut dans son orbite, indifférente aux luttes des nations dont les dissensions ensanglantent sa surface.
Du haut du couronnement, nous vîmes dans notre sillage les bras et les têtes des Indiens qui se débattaient au milieu des flots. Par une impulsion involontaire, je fis observer à Marbre que nous pourrions en sauver quelques-uns.
— Laissez-les se noyer ! et allez au diable, répondit le premier lieutenant.
— M. Marbre a raison, ajouta Nabuchodonosor. On ne peut rien attendre de bon des Indiens. Ils vous noieront, soyez-en sûr, si vous ne les noyez pas.
Je jugeai que toutes mes instances seraient inutiles, et toutes les victimes disparurent successivement. Le Grand-Sec les suivit des yeux, et l'expression de sa physionomie me prouva que, malgré son endurcissement, il était profondément touché du désastre inattendu qui décimait sa tribu.
Peut-être avait-il des fils et des petits-fils parmi ces infortunés qu'il regardait pour la dernière fois. Néanmoins il se roidissait contre la douleur. Au moment où la dernière tête s'enfonça, je le vis frémir. Un gémissement étouffé lui échappa, puis il baissa la tête et demeura immobile comme un arbre de ses forêts natales. Je demandai à Marbre la permission de délier les bras du vieillard. Il me l'accorda non sans proférer quelques jurons à l'adresse du chef indien.
On mit le navire en panne à un mille de la passe méridionale qui conduisait dans la baie. En passant devant l'île nous tirâmes notre bordée de bâbord au milieu des buissons et des arbres, et nous jugeâmes par les cris que nous entendîmes que Marbre ne s'était pas trompé sur la position de l'ennemi.
...
Sur Mer et sur Terre
Romans Populaires Illustrés
L’histoire de ces jeunes qui doivent choisir une carrière.
Devenir navigateur ou avocat, voilà ce qui s’offre à eux.
Des aventures à couper le souffle, comme seul M. Cooper sait les raconter.
À vous d’en juger !
Avec un formatage aéré, comme toujours.