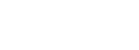La campagne canadienne
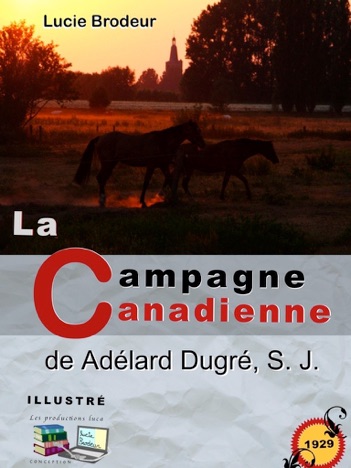
Voyez comment les canadiens français ont réussi à défricher leur pays. Et les conditions difficiles qu'ils ont dû rencontrer pour réussir à garder le fort francophone alors qu'ils étaient entourés et dirigés par des anglais.
Auriez-vous fait comme eux ? Quelle décision auriez-vous prise ? Suivez cet épisode de la vie à la campagne en ces années difficiles mais heureuses.
Sommaire
Prologue
PRÉFACE
Chapitre Premier - L'ARRIVÉE
Chapitre Deuxième - AU LOIN
Chapitre Troisième - À LA MAISON
Chapitre Quatrième - DIMANCHE
Chapitre Cinquième - LE SOUPER DE FAMILLE
Chapitre Sixième - ENTRE FRÈRES
Chapitre Septième - ENNUIS
Chapitre Huitième - AUX CHAMPS
Chapitre Neuvième - DANS L'INTIMITÉ
Chapitre Dixième - SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Chapitre Onzième - CHACUN CHEZ SOI
CONCLUSION
Mot de la fin
Des livres captivants ?
Prologue
Voici un livre que j’ai trouvé dans une charmante boutique de livres usagés. Après mes recherches, je me suis rendue compte qu’on ne le retrouvait pas en ebook.
Après l’avoir lu, je me suis dit qu’il représentait la pensée et l’histoire des canadiens français à une certaine époque. Qu’il valait sans aucun doute la peine d’être publié pour qu’on puisse se faire une idée des sacrifices des gens qui ont forgé cette partie francophone de notre pays.
On y retrouve également l’influence que la religion avait sur leurs vies.
C’est à cause de ces gens qu’au Québec on parle encore la langue de Molière, malgré les administrations anglaises et de la proximité des États-Unis.
L’histoire se passe principalement dans la région de Trois-Rivières, à mi-chemin entre Montréal et Québec, tout près du fleuve Saint-Laurent. Cette région fait toujours partie du circuit touristique de la province.
Ce livre a été publié en 1929 par l’Imprimerie du Messager, 4260 de Bordeaux, à Montréal. L’auteur est Adélard Dugré, S. J. (pour Societas Jesu, et placé ainsi après un nom, indique que c’était un Jésuite).

Page titre du livre original qui a été lu plusieurs fois.
Publication autorisée par : Archives des Jésuites au Canada, 7 mars 2014
PRÉFACE
Il existe actuellement, dans l'Amérique du Nord, deux civilisations fort différentes : l'une représentée par cent millions d'Anglo-Saxons, l'autre par trois ou quatre millions de Canadiens d'origine française.
Ce qui distingue ces deux groupes inégaux, ce n'est pas seulement la langue qu'ils parlent et la foi religieuse de la grande majorité de ceux qui les composent, c'est aussi la diversité dans les manières d'agir, la divergence de vues dans leurs jugements sur la vie, ses jouissances et ses devoirs.
On a hérité, au Canada français, du tempérament et des traditions de la France catholique du dix-septième siècle.
On a hérité, chez les Américains anglo-saxons, du libre examen et de l'esprit utilitaire des Anglais du règne d'Élisabeth. Un climat froid, une nature calme, des conditions économiques difficiles, une foi religieuse robuste, ont développé chez les Canadiens français l'endurance dans les travaux pénibles et la facilité de contentement ; un climat tempéré, une nature généreuse.
L'abondance des richesses, ont développé chez les Américains le goût de vivre et l'attachement aux biens terrestres, tandis que le mysticisme des pionniers puritains faisait place chez eux à une indifférence religieuse de plus en plus accentuée.
Cette opposition dans le caractère des deux groupes ethniques se trahit constamment dans la pratique de la vie : l'exercice du culte divin, les coutumes familiales, l'éducation, la littérature, le commerce et la réclame, les procédés électoraux, les fêtes populaires, tout traduit à l'observateur le moins attentif, les profondes différences qui distinguent le Canadien resté français de l'Américain-type.
Or, voici que le Canadien français, pris d'admiration pour l'esprit américain, se défait peu à peu de ce qui le caractérise. Les campagnes elles-mêmes ne sont plus un refuge assuré pour nos vieilles coutumes.
Depuis longtemps déjà, mais surtout depuis l'invasion de nos paisibles paroisses par la grosse presse, l'automobile et les catalogues des grandes maisons d'affaires, nos bonnes gens s'enorgueillissent d'adopter le langage, les modes, les mœurs de la ville, qui sont une imitation de la langue, des modes et des mœurs américaines. La ville, les États-Unis, fascinent l'imagination de nos bonnes populations campagnardes et les poussent à se déguiser en citadins des États.
Comment réagir ? Prêcher la fidélité aux vieilles coutumes, on ne nous comprend guère, parler d'attachement au sol ou de retour aux champs, on ne nous écoute pas ou l'on nous prête des motifs intéressés. Vanter les avantages de la campagne paraît une plaisanterie, quand on compare le salaire de l'ouvrier aux revenus du cultivateur. Les plus éloquents discours risquent d'irriter davantage des âmes déjà aigries.
Le meilleur argument en faveur de la campagne et des traditions anciennes, c'est la campagne elle-même. C'est pourquoi nous avons voulu la montrer sous quelques-uns de ses aspects, avec ses vertus, ses travaux, ses plaisirs.
Nous avons voulu faire soupçonner aux agriculteurs que leur sort, malgré ses âpretés, fait envie à bien des gens de ville. Nous avons voulu faire comprendre aux Canadiens que le plus court chemin pour arriver au bonheur, c'est de rester Canadiens.
Et pour donner quelque attrait à nos descriptions et à nos enseignements, nous nous sommes permis de les situer dans un cadre déterminé, d'y mêler l'action de quelques personnages, afin d'opposer ainsi plus fortement l'esprit américain à l'esprit traditionnel de la famille canadienne-française.
Chapitre Premier – L’ARRIVÉE
Le train de six heures quarante allait apparaître dans quelques minutes. Dans la petite station de la Pointe-du-Lac le télégraphiste, Brunet, le charretier, Jos. Gaboury, et deux ou trois cantonniers, que la pluie avait contraint d'y chercher un refuge, jasaient paisiblement en écoutant tomber les dernières averses d'un gros orage de juillet. Le pied sur un banc, le coude appuyé sur le genou, le gros Gaboury regardait par la fenêtre.
– Tiens ! fit-il soudain, le père Barré qui vient aux chars.
En effet, une grosse voiture à quatre poteaux, entourée de toiles cirées, quittait la grand’route et s'avançait en cahotant vers la station. Les flâneurs s'approchèrent pour la voir venir : c'était bien le vieux Baptiste Barré, d'en bas de la paroisse, qui venait apparemment chercher des voyageurs. Il était seul dans sa voiture.
Arrivé à la station il se glissa de son siège, amarra son cheval avec un gros câble à l'une des crampes qui garnissaient le rebord du quai et pénétra dans la salle d'attente en frappant par terre ses grosses chaussures couvertes de rosée. D'un geste large il salua le chef de gare et les autres campagnards qui l'accueillaient d'un bonjour amical.
– Bonjour la compagnie ! dit-il sur un ton de contentement.
– Beau temps pour se promener, père Barré ! dit l'employé du chemin de fer sur un ton de plaisanterie.
– Joli temps, oui ! fit le bonhomme en ouvrant son pardessus. Heureusement que j’étais parti de bonne heure : j'ai laissé passer le gros de l'orage chez Félix Du val. Je ne suis pas en retard, toujours ? Le train n'est pas passé.
– II arrive dans la minute, M. Barré. Il vient de partir d'Yamachiche.
– Oh ! bien, dans ce cas, j'ai bien fait de ne pas me presser... Savez-vous, ajouta le vieillard, que nous avons des chances de retourner au beau temps ?
Et s'approchant de la fenêtre, il sonda l'horizon d'un œil expérimenté. Par-delà les fermes environnantes, il montra le couchant, qui déjà se débarrassait de ses nuages et laissait pressentir une barre rouge à l'horizon.
– Le temps va se réparer vite, dit Baptiste, vous allez voir.
C'était un grand vieillard au nez d'aigle, aux sourcils épais, dont la figure énergique et placide s'entourait d'un moelleux collier de barbe grise. Malgré son bel air de vigueur on le devinait âgé, dépassant de beaucoup la soixantaine. Tandis qu'il achevait de secouer ses vêtements mouillés par l'orage et qu'il bourrait sa pipe, on se dit les banalités ordinaires sur les bienfaits de la pluie et les apparences de belle récolte.
Puis Gaboury, propriétaire de l'hôtellerie voisine, en même temps postillon, cocher de place et charretier, posa la question qui intriguait tous ces curieux :
– Vous attendez des voyageurs, père Barré ?
– Oui, dit Baptiste.
Et il expliqua qu'il venait recevoir son garçon, François, le docteur, qui arrivait des États-Unis avec sa famille.
– Docteur ? dit le télégraphiste.
– Docteur, oui Monsieur, reprit Baptiste avec fierté. Vous ne l'avez pas connu, vous ; c'était du temps de Poliquin. Il est parti avant votre arrivée. Il y a dix-neuf ans passés qu'il est parti, presque vingt ans.
– Où est-il maintenant ? demanda l'hôtelier.
– Il est toujours à la même place, aux États, à Superior. C'est une grande ville, quelque part du côté du Michigan.
– Eh ! machine ! c'est loin ?
– Ce n'est pas proche.
– Il n'est pas revenu, si je compte bien, depuis qu'il est rendu aux États ?demanda l'un des cantonniers.
– Non, c'est la première fois qu'il vient depuis qu'il est parti.
– Il n'est tout de même pas sorteux, votre François, père Barré, lança un robuste cultivateur du voisinage, qui était arrivé sur les entrefaites. Vingt ans sans venir vous voir !...
– Dame, reprit vivement Baptiste, le Michigan, tu sais, ce n'est pas chez le voisin.
– Mais pour un homme qui fait de bonnes affaires !
– Oui, mais il a des occupations aussi. Et puis, voyez-vous ? – et l'aveu paraissait être pénible au vieillard – il s'est marié par là avec une Américaine qui ne sait pas beaucoup le français...
Baptiste, qui avait fini de bourrer sa pipe, fit craquer une allumette, aspira bruyamment de longues bouffées de tabac et reprit ses confidences.
...
Mots clés : La campagne Canadienne, Adélard Dugré, S.J., canadiens français, canadiens anglais, américains, jésuites, médecin aux États-Unis, Trois-Rivières,
Dans le iBookstore
Ou... sur Amazon
Dans le iBookstore
Ou... sur Amazon
Sur YouTube